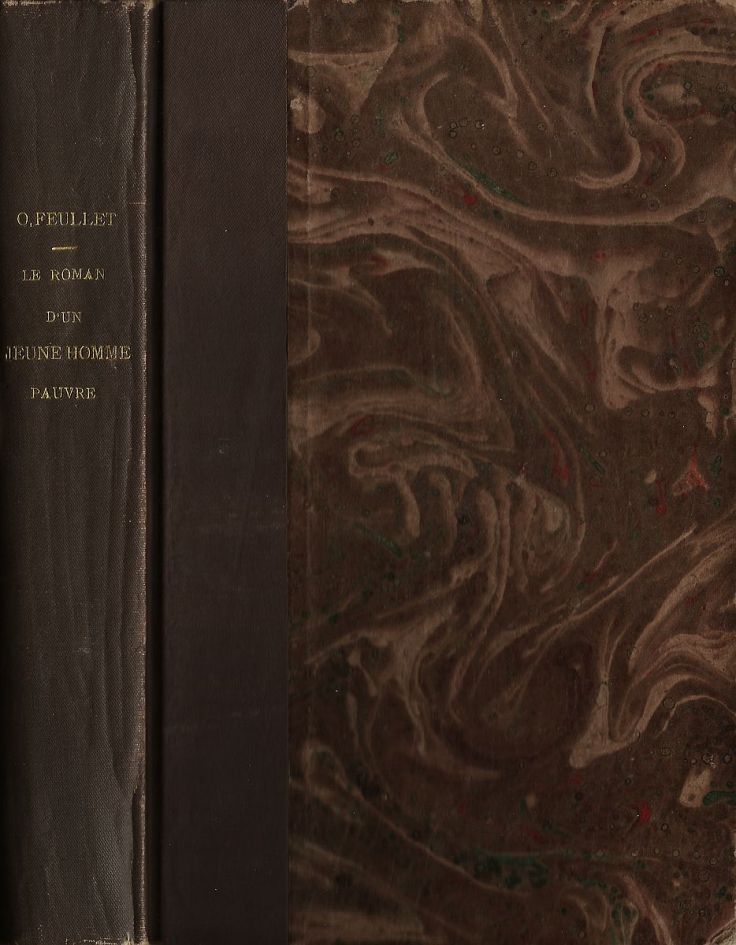 Réimpression de 1899 par Calmann-Lévy
Réimpression de 1899 par Calmann-Lévy
Nous sortîmes donc ensemble du jardin; je lui tins l’étrier pendant qu’elle montait à cheval, et nous nous mîmes en marche vers le château. Au bout de quelques pas :
– Mon Dieu ! monsieur, me dit-elle, je suis venue là vous déranger fort mal à propos, il me semble, vous étiez en bonne fortune.
– C’est vrai, mademoiselle; mais comme j’y étais depuis longtemps, je vous pardonne, et même je vous remercie.
– Vous avez beaucoup d’attentions pour votre pauvre voisine. Ma mère vous en est très reconnaissante.
– Et la fille de madame votre mère ? dis-je en riant.
– Oh! moi, je m’exalte moins facilement. Si vous avez la prétention que je vous admire, il faut avoir la bonté d’attendre encore un peu de temps. Je n’ai point l’habitude de juger légèrement des actions humaines, qui ont généralement deux faces. J’avoue que votre conduite à l’égard de mademoiselle de Porhoët a belle apparence; mais… – Elle fit une pause, hocha la tête, et reprit d’un ton sérieux, amer et véritablement outrageant : – Mais je ne suis pas bien sûre que vous ne lui fassiez pas la cour dans l’espoir d’hériter d’elle.
Je sentis que je pâlissais. Toutefois, réfléchissant au ridicule de répondre en capitan à cette jeune fille, je me contins, et je lui dis avec gravité :
– Permettez-moi, mademoiselle, de vous plaindre sincèrement.
Elle parut très surprise.
– De me plaindre, monsieur ?
– Oui, mademoiselle, souffrez que je vous exprime la pitié respectueuse à laquelle vous me paraissez avoir droit.
– La pitié ! dit-elle, en arrêtant son cheval et en tournant lentement vers mois ses yeux à demi-clos par le dédain. Je n’ai pas l’avantage de vous comprendre !
– Cela est cependant fort simple, mademoiselle : si la désillusion du bien, le doute et la sécheresse d’âme sont les fruits les plus amers de l’expérience d’une longue vie, rien au monde ne mérite plus de compassion qu’un cœur flétri par la défiance avant d’avoir vécu.
– Monsieur, répliqua mademoiselle Laroque avec une vivacité très étrangère à son langage habituel, vous ne savez pas de quoi vous parlez ! Et, ajouta-t-elle plus sévèrement, vous oubliez à qui vous parlez !
– Cela est vrai, mademoiselle, répondis-je doucement en m’inclinant; je parle un peu sans savoir, et j’oublie un peu à qui je parle; mais vous m’en avez donné l’exemple.
Mademoiselle Marguerite, les yeux fixés sur la cime des arbres qui bordaient le chemin, me dit alors avec une hauteur ironique :
– Faut-il vous demander pardon ?
– Assurément, mademoiselle, repris-je avec force; si l’un de nous deux avait ici un pardon à demander, ce serait vous : vous êtes riche, je suis pauvre : vous pouvez vous humilier… je ne le puis pas !

Une fois n’est pas coutume, mon article de la semaine ne sera pas consacré à un ouvrage obscur et oublié, mais à ce qui fut en son temps un authentique « best-seller », un immense succès commercial et populaire, qui fut adapté de nombreuses fois au théâtre (dont l’année même de sa publication, directement par l’auteur), ainsi que six fois au cinéma, en France et en Italie, et par des noms aussi prestigieux que ceux d’Abel Gance ou d’Ettore Scola.
« Le Roman D’Un Jeune Homme Pauvre » reste encore aujourd’hui un titre de roman assez connu, et pas seulement des bibliophiles. Il n’est, par contre, plus tellement lu, et assez universellement perçu comme désuet. Est-ce là un à-priori dénué de fondement ? C’est ce à quoi nous allons tenter de répondre aujourd’hui.

Parlons d’abord de celui qui en est l’auteur : OCTAVE FEUILLET (1821-1890). Issu d’une famille bourgeoise et quelque peu misanthrope de la Haute-Normandie, Octave Feuillet a traversé le XIXème siècle, tout le long d’une carrière somme toute brillante et reconnue en son temps. Pourtant, c’est avant tout l’ennui qui motivât sa vocation, l’ennui de la vie morne et sans grande perspective des environs de Saint-Lô, sous la coupe d’un père tyrannique et sujet à des sautes d’humeur (sa mère étant morte alors qu’il était enfant). Son père vécût très mal d’ailleurs la vocation littéraire d’Octave, qu’il destinait à la profession plus prestigieuse de diplomate. Il le chassa de chez lui, et Octave partit chercher fortune et renommée à Paris, vivant de piges journalistiques et des revenus enthousiasmants de ses trois premiers romans, publiés sous le pseudonyme de Désiré Hazard, afin de ne point salir le nom paternel. Devant le succès obtenu par les premiers écrits de son fils, Jacques Feuillet pardonna au bout de trois ans la décision de son fils, et reconnut son talent. Octave revint donc habiter à Saint-Lô, épousa la fille du maire et commença une existence bourgeoise et paisible, qui fut sans doute pour beaucoup dans l’esprit apaisé et apaisant de ses romans, se situant souvent dans des petits manoirs isolés de province, où vivent aristocrates désargentés, grands bourgeois en crise, monarchistes inconsolables, tout un microcosme pleurant une splendeur passée au milieu duquel Feuillet narre les difficultés d’une histoire d’amour naissante, pleine de rêve et d’espoir, dans un contexte familial ou un voisinage sclérosé dans le passé.
Trame classique, quasiment shakespearienne. Il ne faut pas attendre grand chose de novateur d’Octave Feuillet. Il est avant tout le pur produit de son environnement immédiat et de son époque. Son père était un royaliste hostile à Napoléon III, alors qu’Octave fût plus volontiers favorable au Second Empire, qu’il juge plus moderne et progressiste (ce qui en un sens était vrai).
La carrière d’Octave Feuillet décolle d’ailleurs en harmonie parfaite avec la naissance du Second-Empire. L’œuvre littéraire du jeune écrivain s’inscrit totalement dans cette insouciance sereine – et un peu déconnectée du réel – qui fut l’esprit du règne de Napoléon III. Sa peinture des nostalgiques résignés de la Monarchie de Juillet séduisait autant ceux-là mêmes qu’ils décrivaient, touchés de se voir aussi bien compris, que les convertis à l’impérialisme, rassurés de voir les monarchistes aussi joliment peints comme une force déclinante. Le couple impérial appréciait fort Octave Feuillet, qui était un des familiers de l’impératrice Eugénie. Presque toutes ses pièces de théâtre furent jouées dans le palais impérial de Compiègne.
Une telle proximité avec la famille Bonaparte se paya un jour. Lorsque l’Empire tomba en 1870, Octave Feuillet tomba avec lui. Dépossédé de son emploi de bibliothécaire impérial au château de Fontainebleau, gracieusement offert par l’Empereur, il se retrouva ruiné, obligé de vendre le manoir de son père, et vécut pauvrement et de manière instable jusqu’à la fin de sa vie, grâce aux quelques milliers de personnes qui continuaient à acheter ses livres. Après sa mort, il tomba dans l’oubli pendant presque un demi-siècle, jusqu’à ce qu’Abel Gance exhuma son roman le plus célèbre pour en faire un film à succès.
« Le Roman D’Un Jeune Homme Pauvre » paraît en 1858, année charnière pour Octave Feuillet. Son père vient de mourir et le poids de cette autorité paternelle marque la fin d’une époque et le début d’une nouvelle vie. C’est ce qui transparait dans son roman, qu’on ne qualifiera pas d’autobiographique, mais qui puise indéniablement ses qualités dans l’épreuve que traverse Octave Feuillet, au moment de sa rédaction.
L’histoire commence aux environs de Grenoble, chez une famille d’aristocrates, les Odiot de Champcey d’Hauterive, un couple vieillissant qui vit avec leur jeune fils Maxime, tandis que la sœur cadette est interne dans un pensionnat religieux. La disparition rapprochée de Mme de Champcey d’Hauterive, puis de son irascible mari (fortement inspiré du père d’Octave), plonge brutalement le jeune homme dans la vie adulte. C’est alors que le notaire familial, M. Laubépin, apprend à Maxime la terrible nouvelle : ses parents étaient criblés de dettes, et ne lui laissent rien d’autre.
Si la ruine est tragique, et tous les biens revendus pour éponger la dette, la préoccupation de celui qui ne veut plus être appelé que Maxime Odiot, c’est de tenir sa sœur Hélène ignorante le plus longtemps possible du drame qui vient de les laisser tous deux seuls au monde et misérables. La rente restante servira d’abord à payer l’internat et les études d’Hélène jusqu’à sa majorité. Quant à Maxime lui-même, il se résout à chercher du travail. Tâche ingrate, pour un jeune homme sans qualifications et qui, honteux de sa chute dans la hiérarchie sociale, cache à tous ceux qu’il rencontre ses origines nobles et ses diplômes, qui seraient peut-être de nature à inspirer confiance. Il finit par ne plus avoir de quoi manger tous les jours, d’où cette scène terrible, un jour où il rend visite à sa sœur Hélène, laquelle ignore encore la mort de son père et l’engloutissement de leur fortune.
 Château de Cemper, près de Brocéliande
Château de Cemper, près de Brocéliande
Néanmoins, le calvaire de Maxime Odiot sera de courte durée, car Laubépin, le notaire, désireux d’aider Maxime à trouver du travail, lui présente une opportunité exceptionnelle : il compte parmi ses clients une famille de la haute-bourgeoisie militaire, exclusivement composée de femmes qui entourent un ancien général de l’armée de Napoléon, octogénaire et complètement gâteux, vivant dans le Morbihan, dans les environs de la forêt de Brocéliande. Cette famille n’entend rien à la gestion de sa fortune ou de sa propriété et cherche un « homme d’affaires » – comprenez un comptable / gestionnaire / homme à tout faire – afin de s’occuper de leurs biens et de leur maison.
Maxime accepte la proposition, et part sur l’heure pour la Bretagne.
Il atterrit dans une famille étrange, repliée dans un manoir très isolé, où la figure patriarcale, le général Richard Laroque, est confinée en permanence dans sa chambre. C’est son épouse, Mme Madeleine Laroque, une créole ramenée d’un voyage colonial, qui dirige la maison, avec leur fille commune, Marguerite, jeune femme très belle mais étonnamment renfrognée et perdue dans un monde intérieur.
Sur ce noyau familial se greffent quelques voisines profiteuses et désargentées, Mme Aubry, vieille comtesse ressassant interminablement la chute de la monarchie, et Mlle Helouin, sorte d’originale dame de compagnie obsédée par les sciences, suite à une vocation contrariée d’institutrice. S’ajoute encore un invité plus irrégulier, M. de Bevallan, aristocrate poseur et dissipé, amateur de jolies femmes et de maisons closes, qui courtise ouvertement Marguerite pour sa seule dot, ce à propos de quoi la jeune femme ne se fait aucune illusion.
L’arrivée du jeune et beau Maxime dans cette grande propriété est un évènement qui sort toutes ces personnes de leurs intrigues routinières, et chacune l’étudie avec curiosité. C’est l’un des points forts de ce roman que de décrire avec un soin extrêmement réaliste cette assemblée de personnes sans affinités et néanmoins toujours dans une compagnie gluante et pleurnicharde, qui ne partagent en commun que l’aigreur de leurs regrets d’un passé flamboyant ou d’un chemin délaissé.
Dans cette ambiance étouffante de gens sans avenir et qui vivent dans un ennui aigri, Maxime étouffe vite, tente sans malice de se rapprocher de Madeleine, seule véritable jeunesse de la maison, mais sa mauvaise humeur, son hostilité glacée le tiennent à distance.
Face à un tel accueil, Maxime se résout plutôt à sympathiser avec le voisinage ou avec le petit personnel. Il se prend d’amitié notamment pour une voisine dont lui a parlé Mme Laroque, Mme de Porhoët. Vieille fille, sans enfants, de santé fragile et unique dépositaire d’une vieille aristocratie bretonne ruinée par la Révolution, Mme de Porhoët n’est pas tout à fait une inconnue pour Maxime : les de Porhoët et les Champcey d’Hauterive ont quelques ancêtres communs, ce qui fait que cette veuve quinquagénaire est en fait une cousine éloignée de Maxime. Celui-ci veut d’abord taire ce cousinage, puis à la faveur d’une remarque ironique sur ses origines, Maxime lui révèle qu’il est un Champcey d’Hauterive.
Cela rapproche le jeune homme et sa vieille cousine, dans un élan familial tenu secret sur lequel la maison Laroque se méprend. Au point que Marguerite sent poindre en elle une jalousie féroce. Alors qu’elle le croise lors d’une promenade à cheval avec Maxime, Marguerite lui fait une sorte de crise de jalousie – mais une crise de jalousie entre gens bien élevés, ce qui est d’une rare élégance et d’une préciosité littéraire tout à fait bienvenue.
Dès lors, le jeu de séduction s’engage entre Maxime et Marguerite, et le roman prend une direction plus résolument romantique, sans pour autant décevoir le lecteur. Bien au contraire, dans ce rapprochement difficile de deux êtres qui tombent amoureux l’un de l’autre par-delà leurs classes sociales et leurs difficultés de communication, Octave Feuillet fait preuve d’une maîtrise narrative, d’un raffinement rhétorique absolument parfaits, et d’une rare élégance. La naissance de cet amour qui saisit les deux êtres malgré leur volonté se tient, notamment dans un autre passage du roman où Maxime sauve le chien Mervyn qui manque se noyer dans un bras de rivière.
Maxime et Marguerite prennent l’habitude de se promener ensemble le soir, une fois que les autres membres de la maisonnée et les domestiques sont couchés et que nul ne peut les voir. Promenades bien innocentes, par ailleurs, mais qui réconcilie Marguerite avec la campagne bretonne. Un soir, ils poussent jusqu’aux tours d’Elven, et parviennent, on ne sait trop comment, à se retrouver enfermés malgré eux dans l’une d’entre elles.
C’est moins la question de leur survie qui pose alors problème aux deux jeunes gens qu’au scandale auquel ils seront exposés lorsqu’on les découvrira le lendemain matin. Personne ne croira évidemment que leur confinement en ces lieux ne cachait pas une escapade sexuelle, aussi immorale qu’inacceptable entre une jeune fille de la haute bourgeoisie et un roturier (car Maxime continue à se faire passer pour tel).
Évidemment, une telle angoisse nous semble un peu dérisoire un siècle et demi plus tard, mais en 1850, dans un petit bourg de province, l’affaire pouvait être sérieuse et valoir une répudiation pour la jeune femme. Heureusement, Maxime parvient à grimper jusqu’à une fenêtre et à se laisser tomber au-dehors pour aller chercher du secours, non sans se casser le bras gauche dans sa chute. Une blessure providentielle, car elle l’innocente d’une escapade amoureuse. Il finit par apercevoir les domestiques de la maison Laroque, toute torches allumées, à la recherche des fuyards.
Se glissant subrepticement dans un fossé, Maxime les interpelle, leur faisant croire qu’il s’est brisé le bras en tombant dans le fossé, et qu’il attend depuis des heures que quelqu’un lui vienne en aide. Feignant d’ignorer la disparition de Marguerite, il fait croire qu’il l’a croisée plus tôt dans l’après-midi, et qu’elle lui aurait dit vouloir se rendre ce soir aux tours Elven. Tandis que la plupart des domestiques foncent vers les tours pour délivrer la jeune femme, deux autres ramènent Maxime à la maison Laroque pour le plâtrer.

Les tours Elven.
Et voilà, l’honneur est sauf, nul n’apprend que les deux jeunes gens étaient ensemble de nuit aux tours Elven, et leurs prétendus accidents réciproques justifient davantage leur rapprochement, puisque chacun à eu la vie sauve grâce à l’accident de l’autre.
La prétendue roture de Maxime n’est même plus un obstacle à un éventuel mariage entre les deux jeunes gens, puisque la perfide Mlle Helouin, amoureuse éconduite par le jeune homme, espionnant ses allées et venues avec Mme de Porhoët, avait fini par surprendre une conversation entre eux sur l’identité réelle de Maxime. Alors qu’elle pensait dénoncer un coureur de dot en révélant que Maxime était un nobliau ruiné, la nouvelle est plutôt bien accueillie par la famille Laroque, surtout quand Maxime explique la difficile déconvenue financière qui a justifié sa mystification.
Reste que Maxime Odiot est pauvre, et que rien ne peut lui apporter une fortune suffisamment considérable pour que son mariage avec Marguerite soit perçu autrement que comme un moyen de se renflouer, y compris pour la principale intéressée.
C’est alors qu’Octave Feuillet sort sa dernière grosse ficelle, la plus énorme, la plus farfelue : le général Richard Laroque meurt brusquement. En ouvrant son testament, on découvre une lettre dans laquelle il révèle qu’il ne s’est jamais appelé Laroque, et n’a jamais été un grand général. De son vrai nom, Richard Savage, il n’était qu’un aventurier anglais qui a fait carrière dans les affaires coloniales, peu de temps après la Révolution Française, en étant régisseur aux Antilles d’une plantation appartenant à un propriétaire français, un certain… Champcey d’Hauterive ! Le propre grand-père de Maxime !
Alors que les flottes anglaises tentaient de reprendre les Antilles à la France, le jeune Savage s’était vu proposer par des espions britanniques des renseignements sur la flotte française dirigé par Champcey d’Hauterive, le propriétaire de sa plantation. Tenté par la somme astronomique qu’on lui proposait, et avec la complicité de sa femme créole avec laquelle il vivait là-bas, Savage a trahi son maître, s’est embarqué pour la France avec la complicité des Anglais, tandis que Champcey d’Hauterive était capturé et grièvement blessé par l’armée anglaise qui, au final, s’empara des Antilles.
Richard Savage s’installa en France et se fit une nouvelle identité française sous le nom de Laroque, et vécut dans l’oisiveté et l’opulence jusqu’à la fin de ses jours. Mais le désormais général Laroque gardait au cœur une sourde culpabilité d’avoir dû son bonheur à une trahison ignoble, et il a décidé sur son lit de mort de léguer la moitié de sa fortune au dernier descendant de celui qu’il a jadis trahi : à savoir, Maxime Odiot de Champcey d’Hauterive, que le hasard a amené sous son toit.
Comme une demi-fortune n’est pas encore tout à fait une fortune, et que la famille Laroque pourrait en vouloir de se faire déposséder au profit de leur employé, voilà t’y-pas que Mme de Porhoët, à son tour, ne se sent pas très bien, une mauvaise fièvre, un coup de sang, qu’importe : elle meurt doucement en léguant tous ses biens au seul membre encore vivant de sa famille : son cousin Maxime Odiot Champcey d’Hauterive !
On dira ce qu’on veut, mais c’est tout de même bien pratique, tous ces vieillards fortunés qui meurent en harmonie en laissant leurs biens au seul homme qui en a vraiment besoin, et qui, nanti de cette fortune tombée du ciel, dont il aura la grandeur d’âme de donner la moitié à sa sœur Hélène, va lui permettre d’épouser Marguerite Laroque sans être soupçonné d’en vouloir à sa fortune.
C’est sur cette édifiante et grossière « happy end » que se termine ce roman…
Qu’en dire donc ?
D’abord que « Le Roman D’Un Jeune Homme Pauvre » est, malgré ce revirement final rocambolesque et un peu balourd, un très bon roman, même s’il ne vaut pas le succès délirant qu’il a pu avoir en son temps. Sur une trame somme toute très académique, très convenue, qui n’est pas sans évoquer Charles Dickens, Octave Feuillet crée des personnages réalistes, tout à fait émouvants, à la fois complexes et typiquement de leur époque. En dépit de son côté huis-clos à ciel ouvert, « Le Roman D’Un Jeune Homme Pauvre » est un témoignage fidèle et tangible de la pensée du XIXème siècle. Il condense d’ailleurs avec bonheur les différents styles en vogue à ce moment-là : roman de mœurs, satire sociale, roman d’amour, et un peu de l’astuce scénaristique outrancière du roman-feuilleton. La maîtrise absolue de l’auteur pour la réalisation de ce difficile patchwork, dans un décor quasiment unique, avec un nombre assez réduit de personnages, est assurément une prouesse littéraire.
Reste que si le roman a de nombreux moments de grâce poétique, et une profondeur émotionnelle permanente, qui reste aujourd’hui encore très touchante pour peu qu’on ait l’âme un peu fleur bleue, il est tout de même un peu court de vues, et cette fin délirante et trop grossièrement arrangeante laisse le goût amer d’avoir été un peu floué en lisant un roman à l’eau de rose amélioré.
Car si, chez Octave Feuillet, le réalisme social et le romanesque sirupeux se mélangent en une recette paradoxalement réussie, le problème vient bien plus d’un fond de conservatisme impérial et d’un goût des convenances prudentes qui poussèrent l’écrivain à effacer d’un goût de baguette magique issue de la Divine Providence un long travail de dissection des âmes et des sentiments qui perd, de ce fait, beaucoup de son sens. Octave Feuillet a-t-il eu peur de faire un livre trop désespéré, trop noir ? A-t-il craint que son public – majoritairement féminin – vive mal une fin moins positive ? S’est-il trouvé à court d’inspiration, en se rendant compte que son héros pouvait difficilement retrouver son statut nobiliaire à moins d’un miracle, voire de deux ?
Toujours est-il que « Le Roman D’Un Jeune Homme Pauvre » demeure une œuvre plaisante à lire, immersive, émouvante, pleine de bons sentiments sans – presque – jamais sombrer dans la niaiserie. C’est un vrai morceau de XIXème siècle à recommander aux amateurs, et si ce n’est pas un classique immortel de la littérature française, c’est un bel objet d’artisanat littéraire, sans aucune prétention et qui s’en tire plutôt bien pour son âge avancé.

Malgré quelques préciosités vieillottes, Octave Feuillet est un écrivain d’une grande fluidité, élégant, plus soucieux de faire des jolies phrases que des phrases complexes. Son style est accessible, facile à comprendre, poétique et romanesque. Aucune connaissance du XIXème siècle n’est requise pour sa lecture, en dépit de quelques détails historiques très anecdotiques. L’esprit est résolument tourné vers la lumière et le positif. On n’y croisera donc aucun propos aigri ou amer, ni aucune considération raciste, bien que l’auteur soit ouvertement un conservateur et un moraliste.
« Le Roman d’un Jeune Homme Pauvre » peut être gratuitement lu en ligne sur le site de Gallica :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5623636m/f5.double.mini.
Le film qui a été tiré de ce roman par Abel Gance en 1935 (en le transposant dans les Années Folles) est visible en intégralité sur YouTube, à l’adresse ci-dessous :
ABEL GANCE – « Le Roman D’Un Jeune Homme Pauvre » (1935)
Laisser un commentaire